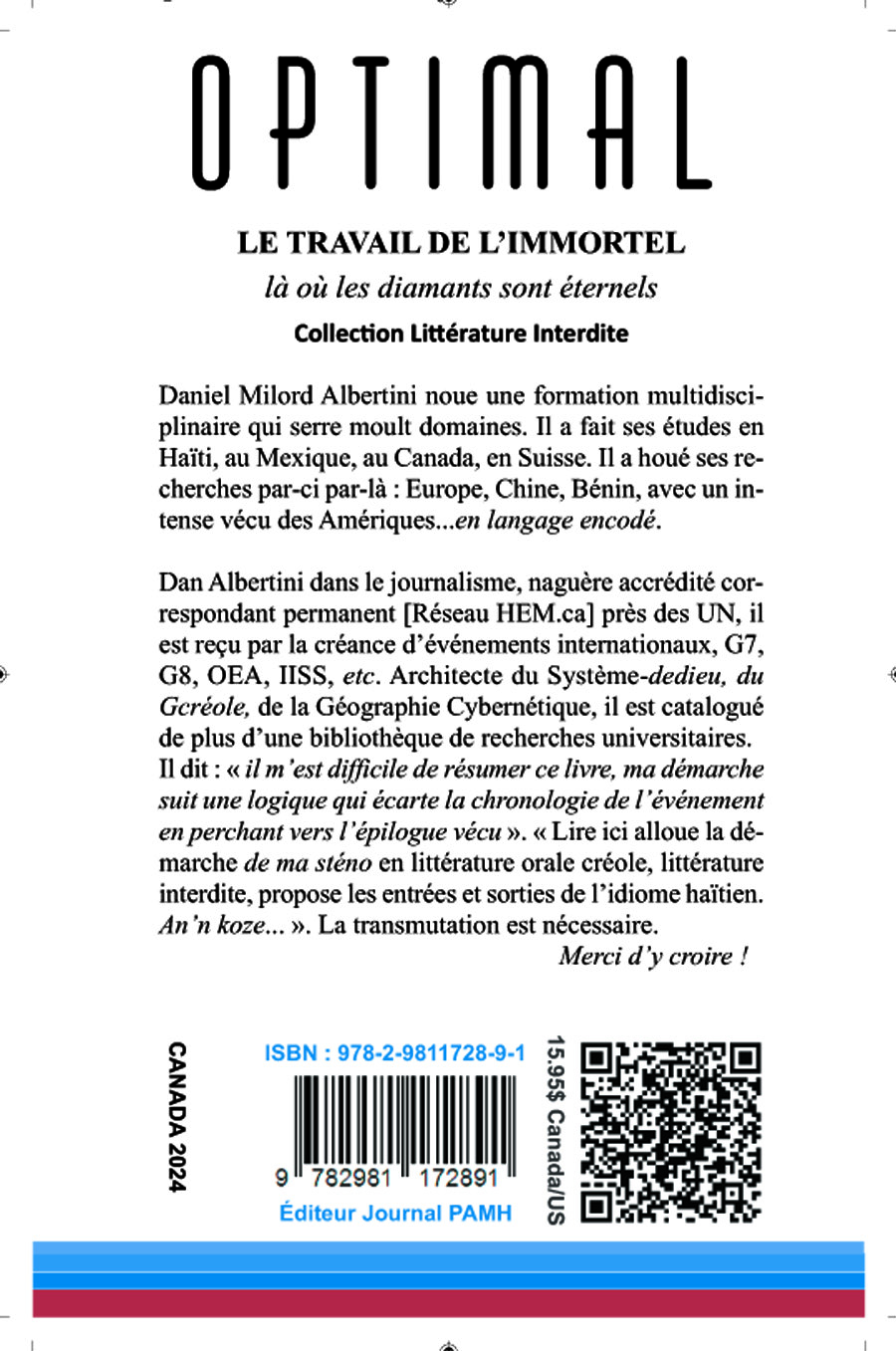Comment les Africains perçoivent-ils la langue française et de quelle manière ils l’utilisent ? Du refus en tant que « langue du colonisateur » à l’adhésion complète comme « langue maternelle », les comportements linguistiques de la population africaine dite « francophone » sont des plus variés. Le témoignage d’intellectuels et d’écrivains permettra de préciser leur position par rapport à la Francophonie en tant qu’institution et à l’utilisation de la langue française comme langue d’écriture.
Pour la plupart, ce n’est pas un choix mais une nécessité puisqu’ils ont été scolarisés dans cette langue. Un grand nombre d’entre eux déplorent cette réalité qui les prive d’une partie de leur culture et de leur identité et souhaitent un retour aux langues africaines pour les générations futures. C’est pourquoi, à la suite d’A. Kourouma qui a « malinkésé » le français, les écrivains africains adaptent la langue classique à leurs besoins et la rendent en mesure de traduire leur moi profond. Mais il n’y a pas que les élites qui s’expriment en français. Des études faites sur la population africaine des grandes villes montrent que là où il n’existe pas de langue ethnique dominante qui puisse servir de véhicule de communication, les classes populaires défavorisées apprennent le français dans la rue. Ce Français Populaire Africain, adapté aux besoins de ceux qui le parlent, s’imprègne des langues locales et de néologismes et s’apparente à l’argot.
Quel sera le futur des langues nationales dans les pays africains francophones ? Comment concilier la survie des langues locales avec l’impératif de la mondialisation ? Le bi ou trilinguisme est-il une solution ? Au cours des siècles à venir l’Afrique pourra-t-elle réaliser le rêve de panafricanisme culturel et linguistique de Cheik Anta Diop ? Questions qui n’ont pas encore de réponses.
En attendant la « Langue Africaine »
(1ère partie)
I – Survol historique de la situation linguistique en Afrique.
La question de l’utilisation de la langue française en Afrique subsaharienne se pose périodiquement. De la confusion entre francophonie et Françafrique à la déclaration de principe : « Nous avons été colonisés », un tour d’horizon s’impose sur les opinions des Africains, sur la manière dont ils perçoivent la langue française et surtout sur la façon dont ils l’utilisent, ceci à travers les écrits des écrivains africains et aussi des déclarations qui pullulent sur certains blogs destinés au sujet.
Parmi les nombreux problèmes auxquels les Africains doivent faire face, celui de la langue n’est pas le dernier. En effet, après la balkanisation de l’Afrique à la Conférence de Berlin en 1884-1885 où les puissances coloniales se partagèrent le continent subsaharien, l’usage des langues européennes fut imposé aux populations de manière autoritaire : anglais et français surtout mais aussi portugais et allemand. Ces nouvelles frontières, découpant arbitrairement l’Afrique en Etats, ne prennent pas en compte les territoires des différentes ethnies et tribus. « Les frontières entre le Soudan et ses voisins francophones ne sont ni géographiques, ni ethniques. On trouve les ethnies de même origine et qui parlent la même langue divisées dans des pays différents ayant des langues officielles différentes » note Amal Madibbo[i]. « Souvent absurdes, ces découpages administratifs ont séparé arbitrairement des groupes humains et créé des régions non viables économiquement. Ils eurent des conséquences non négligeables et ne sont pas étrangers à un certain nombre de conflits qui ont secoué, voire continuent de secouer le continent noir » confirme Moussa Konaté[ii].
Les Indépendances de 1960 ont ouvert la voie à une prise de conscience de la situation linguistique en Afrique qui s’est avérée très chaotique. L’Afrique noire étant constituée de plus de 50 pays, eux-mêmes partagés en centaines d’ethnies et de tribus parlant des centaines de langues et de dialectes, il est difficile de survoler les différences et de parler, en général, de ‘l’Afrique’. Cependant « il nous semble intéressant de relever ce qui unit ces peuples et trace les contours d’une identité noire africaine consistante » peut-on dire après Cheikh Anta Diop[iii] et souligner quels traits sont en commun ; ce sont (à part le Nord et l’Ethiopie) des créations coloniales, artificielles à l’origine, superposées aux territoires préexistants auxquels les colonisateurs ont imposé leur langue. C’est pourquoi il est intéressant de déterminer la place qu’occupe effectivement la langue française sur le continent africain par rapport aux langues locales et nationales[iv].
Pour ce faire, sans négliger les données officielles de l’OIF et de l’Union Africaine (UA), on a accordé une grande attention aux opinions individuelles des Africains, à ceux qui se sont prononcés d’une manière ou d’une autre à travers des blogs, des interviews, des articles, des thèses universitaires ou des ouvrages spécialisés, sans oublier, bien entendu, les écrivains.
La première donnée qui attire l’attention du chercheur, c’est l’assimilation des deux termes de Francophonie et de Françafrique que l’on retrouve souvent dans les déclarations des Blogs. En fait, comme nous le savons, la Francophonie a été fondée aux lendemains des Indépendances par L. Senghor, H. Bourguiba, N. Sihanouk et H. Diori. Au sens institutionnel, elle qualifie l’organisation internationale qui regroupe la communauté de 75 Etats et gouvernements francophones ayant choisi d’adhérer à sa Charte. Au sens large, elle englobe les populations qui ont en commun l’utilisation partielle ou totale du français dans leurs pratiques linguistiques. Le terme de Francophonie a évolué au cours des années. Il a connu des ambiguïtés et même des contradictions, il a recouvert des sens multiples qui vont du simple point de vue culturel jusqu’à une donnée politique plus accentuée à partir de la Nouvelle Charte de la Francophonie de novembre 2005, au point d’en arriver à être confondu avec ce qu’il est convenu d’appeler la Françafrique, c’est-à-dire l’ensemble des relations politiques, économiques et militaires de la France et de ses anciennes colonies africaines.
Au cours d’une interview, Sandra Coulibaly, alors représentante de la Délégation de la Francophonie auprès de l’ONU à Genève définit ainsi la Francophonie : « C’est une vision du monde, le partage de cheminements intellectuels différents à travers une langue commune… elle reflète un espace de communauté ». Elle précise en outre que la Francophonie ne se rattache pas à la politique extérieure de la France. « Nous sommes souvent associés dans une triangulaire plus fantasmée que réelle, entre la Francophonie, la France et l’Afrique, parfois confondus avec un bras armé de la Françafrique. Or nous développons notre propre politique étrangère et de coopération, principalement culturelle […] On doit sortir des questions de la Françafrique pour ouvrir une nouvelle grille de lecture »[v].
II – Les opinions des écrivains africains de langue française.
Or, la plupart des auteurs africains de langue française éprouvent le besoin de préciser leur position. Pour R. Boudjedra : « Il est important de bien différencier la Francophonie, philosophie politique néo-coloniale, du français langue de culture et de civilisation »[vi]. Dans son article sur la Francophonie Alain Mabanckou reprend la définition de R. Fonkoua : « La francophonie désigne les Lettres venues d’ailleurs, mais aussi des manières autres de voir le monde, sinon des manières de voir le monde autrement »[vii]. Madibbo Amal précise dès le début de son essai, le sens qu’il entend donner au mot francophone : « Le terme francophone renvoie à l’utilisation du français comme langue officielle, deuxième langue d’étude ou de travail, ou simplement comme medium de communication. Identifier un pays ou un acteur social comme francophone, signifie également qu’il utilise le français parmi d’autres langues ».
Bien que cette dernière définition soit la plus proche de ce que nous entendons ici, c’est-à-dire parler et écrire en langue française, nous éviterons d’utiliser ce terme pour ne pas causer de malentendus. Nous voulons essayer de comprendre pourquoi d’un côté il y a des Africains qui magnifient la Francophonie en général ou plutôt l’utilisation de la langue française en Afrique et d’autres qui accusent cette même langue d’être, en tant que langue du colonisateur, à l’origine de la plupart des maux du continent subsaharien. Alain Mabanckou, lui-même, fait allusion au problème : « A l’heure où se répand un courant ‘africaniste’ beaucoup d’écrivains d’Afrique noire francophone s’interrogent désormais sur la nécessité de l’utilisation de la langue française comme langue d’écriture »[viii].
1. La langue française : héritage historique
Dans l’ouvrage Indépendances Cha-Cha[ix], trente auteurs s’expriment sur leur rapport avec la langue française. Est-elle encore la langue du colonisateur ou est-elle devenue un patrimoine linguistique national ? Voici quelques réponses :
Nétonon Noël Ndjékéry du Tchad déclare : « J’écris en français parce que c’est la seule langue que je sache vraiment écrire. De plus, le français est devenu par la force des choses, un des éléments constitutifs de notre identité nationale » (Cha190). Jorus Mabiala du Congo Brazzaville précise : « Je travaille beaucoup avec l’Algérie… J’ai emprunté la phrase de là-bas : la langue française est notre butin de guerre. La seule chose que l’on a gagné de cette indépendance, la seule chose positive, c’est la langue française » (Cha 90). Mme Nafissatou Dia Diouf du Sénégal renchérit à propos de la langue française : « On se l’est tellement appropriée que je ne la considère pas ainsi. Nous sommes co-propriétaires de cette langue que nous contribuons à rendre plus vivante et colorée. Le français est plus que ma langue de travail, c’est une langue que j’habite avec armes et bagages, ma culture et mon histoire » (Cha168).
Pour Madame Michèle Rakotoson : « Je suis née dans la langue française et dans la langue malgache. Cela fait partie de l’héritage que j’ai reçu au berceau et je l’utilise, c’est tout » (Cha135). Eric Joël Békalé du Gabon va dans le même sens : « Nous avons été colonisés par la France, comme elle a colonisé bien d’autres pays, et nous avons reçu d’elle un patrimoine culturel et politique. Dans ce patrimoine évidemment, il y a la langue française. Une langue avec laquelle nous ne sommes pas en conflit car nous la considérons désormais comme une langue nationale. Dans bien des cas, elle est la seule langue parlée des Gabonais » (Cha116). Madame Khadi Hane du Sénégal va encore plus loin dans l’appropriation de cette langue : « Le français est la seule langue que j’écris… J’ai appris à écrire en français… Ecrire en français pour moi, c’est naturel. Je dirais même que je réfléchis en français… Le français c’est ma langue. Peut-être pas maternelle, mais c’est ma langue. Je ne peux pas parler d’adoption – ce n’est pas une langue d’adoption – c’est ma langue naturellement » (Cha175). Pour Adamou Idé du Niger, la situation est la même : « La langue française, c’est une langue dans laquelle je pense, qui est mienne. Elle me donne le sentiment de partager une même expérience avec les autres » (Cha161). Kangni Alem du Togo déclare à propos du français : « …J’ai hérité d’une tradition littéraire qui s’écrit dans cette langue-là […] Elle est francophone en ce sens que beaucoup de pays africains y participent. J’ai été formé à la littérature dans cette langue à travers des auteurs français et africains écrivant en français ou traduits en français. Pour moi la question ne s’est jamais réellement posée » (Cha198).
Comme l’a souligné Mme Sandra Coulibaly, la langue française désormais fait partie de la culture des auteurs africains qui écrivent « sans complexe en français ». Elle rappelle les mots de Senghor, poète et président du Sénégal au moment des indépendances : « Comme toute aventure humaine, la colonisation a charrié de la boue et de l’or. Pourquoi ne faudrait-il prendre que la boue et ne pas retenir les pépites ? ». « Dans les décombres de la colonisation nous avons ramassé cet outil merveilleux qui est la langue française… »[x]. C’est également l’avis exprimé dans le Blog d’Alain Mabanckou : « La langue française pour un francophone est un héritage historique dont celui-ci doit ponctuellement en (sic) tirer le meilleur parti, sans s’enorgueillir parce que les conditions du legs étaient viciées au départ »[xi].
2. La langue française : langue du colonisateur.
Par contre, certains intellectuels originaires de pays autrefois colonisés par la France remettent en cause le concept de francophonie dont la politique est considérée comme une forme de néo-colonialisme. Ils rendent la langue française responsable de l’aliénation culturelle dans laquelle est plongée le Continent subsaharien et accusent les écrivains qui l’utilisent de continuer l’œuvre du colonisateur. A la suite de l’article d’Alain Mabanckou, sur le Congopage blog on peut lire cette intervention : « Donc les écrivains africains francophones sont de près ou de loin des émissaires de la France. En cela je rejoins parfaitement les arguments de M. Nganang dans le sujet un peu plus bas de ce blog. Il faut cesser d’être francophone, de soutenir une langue qui n’est pas la nôtre, une langue qui tue les langues africaines ». Opinion partagée par d’autres ’blogueurs’ : « Vous avez de la chance d’avoir un Alain Mabanckou et le fait qu’il écrive en Français ne veut point dire qu’il n’est pas Congolais… car lui au moins il vous aime un peu et a le mérite de dénoncer cette secte appelée ‘La Francophonie’, les nôtres ils ne nous aiment pas trop à quelques exceptions très rares », ou plus loin : « Encore un débat inutile. La francophonie n’est rien d’autre qu’un espace politique au service de l’impérialisme et du néo-colonialisme français ». De plus « la langue française devient en Afrique une langue de dépendance et de négation de l’être originel » écrit A. Kom dès 1979[xii].
Les écrivains eux-mêmes ont leur mot à dire. Dans Le Sanglot de l’homme noir Alain Mabanckou rappelle que « le Camerounais Patrice Nganang notamment, va jusqu’à proposer ‘d’écrire sans la France’, pour reprendre sa propre formule. Proposition, voire exigence, puisque, d’après lui, ceux qui ne s’y plieraient pas seraient coupables de cautionner l’idéologie coloniale ». Plus loin il précise : « L’argument principal de ceux qui souhaitent aujourd’hui ‘écrire sans la France’ est que le français serait entaché d’un vice rédhibitoire, insurmontable, inexcusable : c’est la langue du colonisateur. C’est une langue qui ne nous permettrait guère de nous exprimer avec authenticité […] Selon les partisans de l’authenticité, la langue française véhiculerait des ‘codes’ d’asservissement, des tournures impropres au phrasé africain que nous aurions tort de sous-estimer »[xiii]. Moussa Konaté renchérit : « …Que dire de ces créateurs, supposer restituer l’âme de leur peuple, qui ne s’expriment que dans des langues européennes et ne se sentent exister que dans la mesure où ils reçoivent l’onction de la critique occidentale ? Pour être accessibles à leurs compatriotes, ils doivent être traduits d’une langue étrangère ! »[xiv]
3. La langue française : produit de la liberté .
Par contre, de nombreux écrivains s’élèvent contre cette conception de la langue française. Gaston Kelman, Camerounais lui-aussi, déclare : « La colonisation (c’est) la chose la plus horrible au monde […] C’est la barbarie la plus grasse ! […] Ce n’est pas parce que la colonisation c’est la barbarie, que la langue française c’est la barbarie ! » (Cha 53). Mamadou Mahmoud N’Dongo : « Dans mon cas, c’est une langue que j’ai choisie. Je suis un écrivain d’expression française. Ce n’est pas une langue tortionnaire » et Wilfried N’ Soudé expriment le même concept de manière très suggestive : « Non mais attendez ! Il faut arrêter avec ça ! Ce n’est pas que la langue du colonisateur ! […] Quand je parle l’allemand, je ne parle pas la langue du bourreau nazi, enfin !… ». « La langue française n’est pas un produit du colonialisme mais, au contraire, un produit de la liberté. La France n’est pas seulement le colon, c’est aussi Voltaire, Rousseau, Aragon. Le français n’est pas la langue de la colonisation. Les colonisateurs n’avaient pas de langue, ils avaient des fusils… et une administration » renchérit Beyrouk de Mauritanie (Cha148).
Ousmane Diana du Mali signale le danger représenté par le refus de la langue française pour les jeunes auteurs, surtout, qui ne savent pas s’exprimer dans leur propre langue et donc ne peuvent se réaliser pleinement. « Je connais des jeunes […] qui écrivent de beaux textes en français. Si on leur assène cela, alors qu’ils n’ont pas appris à écrire dans leur langue cela développe un complexe et tue la création. Que ceux qui militent et qui ont la capacité d’écrire dans leur langue, qu’ils écrivent, c’est une excellente chose. Mais qu’on ne considère pas ceux qui n’ont appris à écrire qu’en français, à ne communiquer leurs émotions qu’en français, comme des traîtres. Qu’on arrête cela ! » (Cha143).
Alain Mabanckou poursuit en ces termes : « Etre francophone, cela empêcherait-il d’être un écrivain ? L’ombre de la France serait-elle si pesante qu’elle nous empêche d’écrire en toute liberté. Nous n’avons pas encore compris qu’il y a longtemps que la langue française est devenue une langue détachée de la France, et que sa vitalité est également assurée par des créateurs venus des cinq continents ? ». L’auteur va plus loin dans le refus de cette vision rétrograde de la langue française. Il dénonce l’attitude de ceux qui sont restés attachés aux fausses valeurs précoloniales : « Il n’y a pas d’un côté les vendus, les larbins qu’on applaudit dans les salons, et, de l’autre, les dignes, les résistants munis d’un brevet d’africanité délivré par on ne sait quelle instance. Et pourtant, hostiles aux changements, dépassés par le cours des événements, les gardiens autoproclamés de l’authenticité africaine, épigones des génies de la négritude, demeurent convaincus qu’ils exaltent les valeurs nègres mieux encore que Césaire, Damas, Senghor… »[xv].
III – Les langues régionales africaines.
Gaston Kelman ouvre la porte à un autre aspect de la langue en Afrique que nous voulons explorer et c’est celui de la situation des langues régionales africaines. « Au Cameroun aujourd’hui, personne ne parle plus les langues locales et tout le monde dit : ’Les Blancs nous ont imposé leur langue !’ Si vous n’êtes pas contents du français, il y a le béti, il y a le bassa, il y a le foulfouldé. Mais choisissez une langue et faites-en une langue de communication ! Ou bien prenez une langue africaine ! […] Mais qu’est-ce que c’est que cette pathologie de la plainte permanente ? C’est le Blanc qui vous interdit de choisir une langue ? Moi, au moins, le français me permet de communiquer. » (Cha 54).
Moussa Konaté va au cœur de la question : « … Le problème n’est pas que les auteurs écrivent dans une langue européenne, mais le fait qu’ils soient incapables de le faire dans leur langue maternelle. Ils n’en sont pas responsables, mais le problème n’en reste pas moins »[xvi].
1. Promouvoir les langues régionales.
Cependant tous les écrivains d’expression française sont unanimes sur la nécessité de promouvoir les langues locales qui ont une place prépondérante non seulement dans la construction culturelle et identitaire d’un pays mais aussi dans le développement social et économique.
En effet, aux lendemains des indépendances, les Etats ont opté pour garder la langue française comme langue nationale. D’une part, à l’époque, le problème de la langue ne semblait pas une priorité pour les pouvoirs publics et les langues africaines restaient encore assez méconnues. De toute façon, on considérait que leur oralité les rendait inaptes à assumer d’autres fonctions que celle de parlers locaux et vernaculaires. « Dispensé en langue européenne, l’enseignement réduisait les langues africaines à des langues de seconde zone. Pour la plupart non écrites, elles étaient depuis toujours le véhicule des cultures dans lesquelles les Noirs Africains avaient baigné et s’étaient conduits. De façon brutale et radicale, les colonisateurs imposèrent leur langue » rappelle Moussa Konaté.
D’autre part, le choix du français comme langue officielle semblait justifié par la nécessité d’unifier le pays et ses ethnies étant donné que les locuteurs africains n’avaient pas de langue nationale commune. Ce qui fait que les écrivains issus de cette période pré et post indépendances ne sont pas en mesure d’écrire dans leur langue maternelle puisqu’ils ont été scolarisés en français[xvii]. Or ces générations qui ont vécu le colonialisme et les indépendances qui les ont déçues sont plus portées à rendre la Francophonie et donc la langue française responsables de cette situation et à ressentir le poids de la langue étrangère sur le destin de leur pays. C’est ce que reprochent nombre de lettrés aux gouvernements des Etats africains comme Tanella Boni par exemple : « La Côte d’Ivoire, au moment de son indépendance, n’a pas fait ce qu’elle aurait dû faire : choisir quelques langues nationales et les imposer comme langues officielles […] Il y a quelques langues véhiculaires comme le dioula et aujourd’hui le nouchi, langue parlée et chantée par les jeunes citadins. Des expériences de scolarisation ont été effectuées dans des langues locales. Mais cela ne suffit pas vraiment » (Cha105).
Voici le témoignage de quelques écrivains africains qui, tous déplorent de ne pouvoir écrire dans leur langue maternelle puisque, ayant été instruits en français, celle-ci s’est trouvée reléguée dans leur existence quotidienne au rang de simple dialecte bon à exprimer les banalités de la vie matérielle
Théo Ananissoh du Togo : « Je n’ai cessé depuis mon enfance, de passer d’une langue et d’une culture à une autre. Je suis né en Centrafrique, j’ai commencé à parler la langue véhiculaire locale qui est le Sango. A l’école, dans les rues, je parlais le Sango. A la maison, comme ma mère et mon père sont des Togolais […] je parlais le Mina, très mal. Et à partir de six ans à l’école, oui, le français. Alors j’ai évolué avec. […]. Je ne peux écrire que cette langue. C’est la langue que je connais. Je ne peux pas écrire ma langue maternelle ». (Cha 204)
Alfred Dogbé du Niger : « C’est le seul outil que j’ai dans les mains. […] Le français est la seule langue que je maîtrise, que je sais écrire. Je sais lire l’éwé, le zarma, le songhaï. […] Je ne peux écrire un texte qui se respecte dans aucune langue africaine. Je n’ai pas appris. On n’a pas encore trouvé le moyen de faire une littérature en langue nationale, écrite aujourd’hui ». (Cha155)
Eric Joël Békalé du Gabon : « J’écris uniquement en français, comme tous les écrivains gabonais. Evidemment, nous avons une sorte de ‘devoir de mémoire’ vis-à-vis de nos cultures. Certains s’essaient aux langues nationales, mais de manière maladroite, en ce sens que ces langues ne sont pas formalisées par une écriture ou un alphabet spécifiques. Toutefois nous faisons des efforts parce qu’il n’est pas question que nos langues nationales meurent. » (Cha 117)
Ils ne peuvent eux-mêmes écrire dans leur langue maternelle pour plusieurs raisons. La première parce qu’ils ont été scolarisés en français et la deuxième parce que nombre de langues africaines sont restées au stade de l’oralité. Elles n’ont pas encore été codifiées pour l’écrit bien que certains Etats fassent un effort pour les normaliser par la création d’alphabets, par la fixation des mots et de l’orthographe. Or, même si ces obstacles étaient surmontés, quels lecteurs pourrait avoir un auteur écrivant dans l’une des langues africaines ? Comment pourrait-il se faire connaître à travers l’Afrique et le monde ?
2. Le foisonnement des langues africaines : un obstacle à l’unité.
En Afrique dite francophone, le français n’est pas l’apanage de toute la population même si c’est une langue officielle. En effet, il cohabite avec les langues locales qui souvent, hors des grandes villes, sont les seuls moyens d’expression connus par une population rurale encore illettrée dans certaines régions de l’Afrique.
Voilà ce que dit le paragraphe 28 du Manifeste du Cinquantenaire du Symposium de Cotonou de novembre 2010 :
« Les langues africaines constituent le socle du patrimoine humain de l’Afrique. Nous voulons qu’elles soient systématiquement inscrites dans les programmes scolaires et enseignées dans tous les cycles scolaires et qu’elles servent de vecteur dans les technologies de l’information et de la communication. De leur appropriation par les Africains dépend aussi le rayonnement de l’Afrique dans le monde ».
C’est aussi l’avis formulé par Moussa Konaté : « …Pour faire advenir la nouvelle élite africaine, (l’école africaine nouvelle) doit tenir pour une priorité la formation de millions de jeunes et d’adultes analphabètes, et cheminer le savoir jusqu’à eux dans leurs langues, par tous les moyens possibles (radio, télévision, cinéma, théâtre…) »[xviii] car, comme l’avait déjà écrit Cheikh Anta Diop : « Il est plus efficace de développer une langue nationale que de cultiver artificiellement une langue étrangère »[xix]. Or pour enseigner une langue, il faut des livres, il faut une littérature spécifique à laquelle faire référence, il faut écrire dans les langues africaines. A la même conclusion était parvenue une étude de l’Université de Montréal en 1963. « Cette priorité accordée à la langue française ne doit pas, cependant empêcher d’enseigner également certains dialectes devenus langues parce qu’ils ont effectivement une morphologie, une structure linguistique, un fondement grammatical désormais incontestable et qu’ils sont parlés par la majorité des populations de quelques-uns de nos pays. Tel est, par ex., le cas du wolof au Sénégal, du bantou au Congo, du yorouba au Nigeria, d’éwé au Togo et fon au Dahomey »[xx].
La difficulté vient de la profusion des langues nationales et locales en usage en Afrique. Voici, à titre d’exemple, quelle est la situation dans quelques pays africains dont l’une des langues officielles est le français. Il y a plus d’une quarantaine de langues nationales au Bénin dont le fongbé est la plus parlée dans le Centre et le Sud. La République Centrafrique utilise le sango comme langue africaine officielle, avec quinze langues nationales et 120 parlers. En République Démocratique du Congo, on compte 221 langues dont 4 ont le statut de langues nationales : le tshilula, le lingala à l’ouest, le swahili à l’est servent de langues véhiculaires. Le kikongo au sud s’étend jusqu’au Gabon qui a, en outre, une vingtaine d’autres langues dont le tsogo au centre, le fang au nord-ouest et le punu au sud sont les plus diffuses. La République du Congo a une quarantaine de langues dont le kituba et le lingala. En Côte d’Ivoire, il y a plus de soixante langues indigènes dont le sénoufo et le dioula sans oublier le malinké si cher à Ahmadou Kourouma[xxi]. Pourtant d’après Tanella Boni « en Côte d’Ivoire il n’y a pas de littérature en langue nationale » (Cha 102).
Au Sénégal, il y a 13 langues nationales reconnues dont le wolof, le peul[xxii], le mandingue. Parmi les langues régionales on note le bambara et aussi le malinké. Mme Khadi Hane déplore la situation : « Je suis Peule. Dans ma famille nous parlons peul, mais j’ai suivi l’école française […]. Les langues africaines je ne les écris pas. Il y a plusieurs langues au Sénégal. Je parle le peul – il y a un alphabet peul, il y a un alphabet wolof, mais je n’ai appris à écrire ni en peul ni en wolof. J’ai appris à écrire en français » (Cha174). N’Dongo témoigne dans le même sens : « J’aurais pu écrire en arabe, j’aurais pu écrire en anglais… Ma langue, aussi – le peul – ne s’écrit pas. C’est une langue phonétique. Mais j’aurais pu inventer une langue pour l’écrire. » (Cha 180). Ousmane Diarra du Mali déclare : « Je peux écrire en français ou dans ma langue maternelle. J’écris quelle que soit la langue. C’est en français que j’ai appris à écrire à l’école, ce n’est pas en Banbara. Le français contribue en grande partie à métisser l’homme de culture banbara que je suis » (Cha 142).
Au Burkina Faso, le bambara fait partie de la soixantaine de langues nationales dont le fulfuldé, le dioula et le mooré sont les trois principales.
Le Cameroun dont on dit qu’il résume l’Afrique à lui tout seul, présente un éventail de 200 à 300 langues. Dans les régions du Nord, de l’extrême nord et une partie de l’Adamaoua le fulfuldé domine comme langue véhiculaire mais on a pu dénombrer plus de 80 aires linguistiques dans ces régions. La situation se présente aussi morcelée dans le Nord-Ouest et le Sud-Est où domine le boulou au milieu d’une soixantaine de dialectes. Dans la Province de l’Ouest, sur 12 autres langues recensées dominent le shu pamon de Foumban et le medumba de Bangangté. Dans celle du Littoral sept aires linguistiques sont dominées largement par le bassa que l’on retrouve aussi dans la Province du Centre. L’ewondo domine la région de Yaoundé et le béti la Province Sud[xxiii].
Le Camerounais Ebodé fait le point : « Le Cameroun compte 200 langues : c’est une richesse regardée comme un obstacle dès qu’il s’agit de s’unir et de fonder une expérience politique commune. Chacun se repliant sur sa langue évite l’autre. Or, le carrefour crée une société et quelques langues peuvent ainsi s’imposer comme des langues de cohésion ou d’exploration ‘poélitique’… En Afrique centrale, il y a des langues comme le lingala parlé dans les deux Congo qui pourraient jouer ce rôle… » (Cha 44).
Cette complexité linguistique constatée en ces pays peut, en un certain sens, justifier le choix, en un premier temps, de la langue française comme langue nationale. Malheureusement, ce qui, à l’origine était un repli dicté par une nécessité historique serait devenu par la suite, selon certains, un choix politique entrainant la lente asphyxie des langues africaines. En effet, selon Moussa Konaté « l’âme d’un peuple se loge dans sa langue, or les langues africaines, souvent reléguées au second plan alors qu’elles ont pour vocation de devenir officielles et nationales, sont encore souvent considérées comme des dialectes par l’Occident, qui s’emploie à en contrer l’enseignement… En Afrique noire, les langues transfrontalières comme le pular, le bambara, le swahili, le yoruba ont toujours existé et n’ont cessé de se répandre. Il ne s’agit donc pas d’ériger arbitrairement une langue en outil exclusif, mais de protéger la diversité linguistique et culturelle du continent »[xxiv] .
D’après ces témoignages, nous pouvons constater qu’un certain nombre de langues africaines dominent par le nombre de locuteurs, par la littérature écrite et orale déjà existante, par la prépondérance politique et sociale et par leur potentiel d’expansion. C’est le cas, pour n’en citer que quelques unes, du wolof, du swahili, du lingala, de l’ewondo, du malinka et surtout du peul que l’on retrouve sous différents noms et dialectes un peu partout dans l’Afrique de l’Ouest. C’est d’ailleurs le fulfuldé que l’UPC et Félix Moumié avaient choisi comme langue officielle du futur Cameroun indépendant.
IV – Trouver une solution.
Cependant, choisir d’enrichir et d’imposer quelques langues africaines privilégiées ne semble pas apporter une solution immédiate au problème des langues en Afrique. En effet, former des jeunes Africains seulement en une langue africaine, c’est courir le risque de maintenir isolés les différents groupes linguistiques, d’accentuer le fossé qui les dépare et de les couper des courants d’échanges internationaux.
Le français est donc, malgré tout, à ce jour, la seule langue écrite qui permette aux pays africains francophones de communiquer entre eux et avec le reste du monde. C’est aussi le seul outil dont disposent leurs écrivains pour la création littéraire avec une audience nationale et internationale. Il n’en reste pas moins que tous, même les plus favorables à l’utilisation de la langue française, regrettent d’être mutilés d’une partie d’eux-mêmes, d’être coupés de leurs origines, de leur langue maternelle qui, seule, aurait la faculté de traduire pleinement leur moi profond. C’est pourquoi, tout en conservant le français comme langue internationale, les Africains commencent à revaloriser leurs langues régionales et à en revendiquer certaines comme langues nationales et même panafricaines.
Comment concilier ces deux aspects de la réalité africaine ? Les romanciers d’une part et la population défavorisée des grandes villes d’autre part vont, chacun à sa manière, apporter une solution qui, au fil des siècles, pourrait aboutir à une « langue africaine ».
[i]Amal Madibbo, L’introduction du Français en Afrique non-francophone : l’expérience soudanaise, in Revue Sud Langues n°2, juin 2003. www.sudlangues.sn/spip.php?article57
[ii]Moussa Konaté, L’Afrique noire est-elle maudite, Fayard, Paris 2010, p.83, note 1.
[iii]Cheikh Anta Diop,L’unité culturelle de l’Afrique Noire, Présence Africaine, 1982. In M. Konaté, op.cit.
[iv] A noter que dans les territoires ex-anglais la situation se présente différemment dans la mesure où les langues maternelles locales sont employées dès le début de la scolarisation pour une durée variable d’un pays à l’autre.
[v]Sandra Coulibaly, 7e Salon Africain du Livre, de la Presse et de la Culture de Genève 2010.
[vi]R. Boudjedra, Diagonales, Entretien.
[vii]Alain Mabanckou, La Francophonie, oui, le ghetto, non !, Le Monde, 19 mars 2006.
[viii]Alain Mabanckou, Le Sanglot de l’Homme Noir, Fayard, Paris 2012.
[ix]Indépendances Cha-Cha, ‘Miniatures’, Magellan & Cie, Paris 2010. Pour éviter une surcharge de notes, nous indiquerons directement dans le texte les pages de référence sous la forme (Cha p).
[x] Sandra Coulibaly, op.cit.
[xi]. Mabanckou Alain, ‘La Francophonie, oui, le ghetto : non !’, Le Monde, 19 mars 2006, Les Grands débats du Blog, Congopage blog, 10 août 2006.
[xii]Ambroise Kom, La langue française en Afrique Noire postcoloniale, 1979.
[xiii]Alain Mabanckou, Le Sanglot de l’Homme Noir, op.cit., p.135 et 138.
[xiv]Moussa Konaté, op.cit., p.209
[xv],Alain Mabanckou, Le Sanglot de l’Homme Noir, op.cit., p. 137 et 155.
[xvi]Moussa Konaté, op.cit., p.211
[xvii]cf. La Marseillaise de mon Enfance, L’Harmattan, Paris, 2004. L’auteur, Jean-Martin Tchaptchet , relate sa vie d’écolier à Bangangté et de collégien à Yaoundé où , peu à peu, les valeurs nouvelles de la société coloniale l’éloignent de son milieu d’origine et de sa culture.
[xviii]Moussa Konaté, op.cit., p.212.
[xix]Cheikh Anta Diop, Nations Nègres et Culture, Présence Africaine, Paris, Dakar 1979.
[xx]L’Afrique noire et la langue française, Erudit Université de Montréal et Laval, 1963.
[xxi]Cf. l’article d’Ariane Poissonnier, Afrique francophone : guerre des langues ou cohabitation solidaire, mars 2010, www.rfi.fr/…/20100319-afrique–francophone-guerre-langues-cohabitati…
[xxii]Le Peul, poular pular, ou foulfouldé, fulfuldé est une langue parlée dans une vingtaine de pays africains ; elle change de nom et varie selon les régions.
[xxiii]cf. Les cultures du Cameroun, Paix et diversité, Collection Rencontres et Terres d’Afrique, Delta papiers, Paris, décembre 2007, Aires linguistiques nationales du Cameroun, p.218.
[xxiv]Moussa Konaté, op.cit., p.206.